Vulnérabilité du sujet à tous les âges de la vie
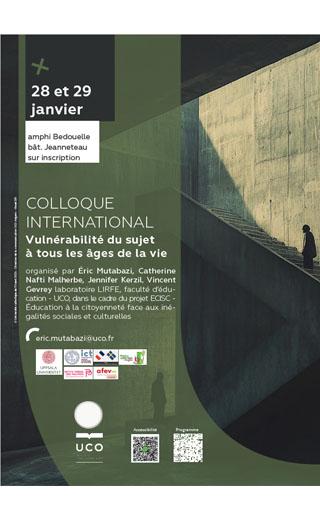
Quel impact pour une inclusion éducative, sociale et professionnelle ? Quel accompagnement scolaire et socioéducatif ? Quels besoins en éducation et formation pour une citoyenneté active ?
Argumentaire
La notion de vulnérabilité renvoie aujourd’hui à une multiplicité de fragilités pouvant toucher les individus dans leur intégrité physique, psychique, sociale ou économique, et les exposant à des risques accrus d’exclusion, de marginalisation, de pauvreté ou de précarité. Ces fragilités résultent souvent de circonstances aggravantes affectant leurs capacités à répondre aux exigences de leur environnement (Dubasque, 2019). Cette notion, bien qu’elle soit devenue courante, est le fruit d’une évolution historique témoignant de changements dans les perceptions sociales et juridiques de la fragilité humaine.
Historiquement, la vulnérabilité a d’abord été associée à des catégories spécifiques de personnes considérées comme « infirmes et incurables ». Cette vision restreinte s’est progressivement élargie pour intégrer des groupes variés : personnes en situation de handicap (physique ou mental), jeunes désocialisés, immigrés victimes de discriminations, personnes âgées considérées comme un poids pour la société, délinquants, personnes dépendantes, ou encore membres du « sous-prolétariat » (Brodiez-Dolino, 2016). Ces groupes ont en commun d’être considérés comme incapables de répondre par eux-mêmes à leurs besoins essentiels et de nécessiter l’interventions de tiers capables de les aider dans la voie qui mène vers une plus grande autonomie en vue de rétablir leur dignité perdue.
Ainsi, à partir des années 2000, la notion de vulnérabilité s’est progressivement affirmée comme un concept fédérateur, permettant d’englober des réalités multiples. Les crises contemporaines ont largement contribué à cette redéfinition, qu’il s’agisse de conflits armés, de catastrophes naturelles, de pandémies, ou encore des conséquences du chômage de masse. Ces crises témoignent du caractère contextuel et transitoire de la vulnérabilité, susceptible d’affecter, au moins provisoirement, n’importe quelle personne. Cette perspective s’inscrit dans une vision dynamique et systémique. Elle montre que l’individu vulnérable n’est pas seulement un sujet passif mais qu’il peut, grâce à un soutien approprié, retrouver une part d’autonomie (Delor & Hubert, 2000).
Le Code pénal français illustre cette évolution en définissant six états de faiblesse – âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, grossesse, et situation économique – comme autant d’indicateurs juridiques de vulnérabilité. Cette reconnaissance ne se déclenche qu’à partir d’un certain degré de fragilité, jugé suffisant pour justifier une intervention légale ou sociale (Brodiez-Dolino, 2016). Elle met cependant en lumière une tension entre la singularité des trajectoires individuelles et l’application de catégories universelles pour définir la vulnérabilité.
Cette notion complexe a également bénéficié d’enrichissements philosophiques et sociologiques. Brodiez-Dolino (2016) s’appuie sur les travaux de Jean-Louis Genard pour évoquer un modèle binaire mettant en évidence un paradoxe fondamental : bien que fragiles, les êtres humains sont dotés de capacités minimales leur permettant de surmonter ces fragilités. Selon cette perspective, la vulnérabilité serait une condition universelle : chacun a à faire face à sa propre vulnérabilité, à différents degrés et à différentes périodes de sa vie. Ce modèle met aussi l’accent sur la capacité humaine à se remettre des accidents de la vie et à construire les réponses adaptées à différentes situations de fragilité.
Cette vision dynamique de la vulnérabilité a des implications importantes pour la recherche mais également pour les politiques publiques. Elle invite à dépasser des approches qui ne seraient que curatives afin d’adopter des stratégies préventives et inclusives, permettant de renforcer les capacités des individus et des groupes à faire face aux défis. Ainsi, l’accès à l’éducation, à la santé et à un environnement socio-économique stable sont autant de leviers pour réduire les inégalités qui aggravent la vulnérabilité (Goudeau, 2020).
Mais la notion de vulnérabilité pose aussi des défis éthiques et politiques majeurs, notamment en éducation et en formation. Nous vivons dans un monde caractérisé par des crises sociales, économiques, et sanitaires (Mutabazi, 2020), par la complexification apportée par les outils numériques et technoscientifiques favorisant à la fois la communication et les inégalités sociales (Granjon, 2009), sans oublier les conditions d’habitabilité de la Terre qui ne cessent de vulnérabiliser les plus fragiles (Steffen et al., 2004 ; Hétier, 2021 ; Wallenhorst, 2021). En tenant compte de ces différents paramètres, comment pouvons-nous déterminer les seuils à partir desquels une intervention et un accompagnement, notamment sur le plan éducatif, sont nécessaires ? Quel est l’impact de différents dispositifs mis en place pour pallier les inégalités et toutes formes d’injustices sociales à l’égard des personnes vulnérables ? En quoi l’accompagnement proposé dans différentes structures éducatives et sociales dès l’enfance et jusqu’à la vieillesse contribue-t-il à l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité ?
Contexte
Ce colloque international aura lieu les 28 et 29 janvier 2026 dans les locaux de l’Université catholique de l’Ouest à Angers.
Il s’inscrit dans le cadre du projet ECISC (Éducation à la Citoyenneté face aux Inégalités Sociales et Culturelles) porté par l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) et se propose d’explorer la vulnérabilité dans toute sa diversité et sa complexité, en adoptant une perspective transversale qui couvre tous les âges de la vie et divers contextes socio-culturels.
Son objectif principal est de mettre en lumière les multiples dimensions de la vulnérabilité ainsi que de favoriser un échange d’idées sur les stratégies les plus efficaces permettant d’y répondre.
À travers une approche interdisciplinaire, il s’agira de mieux comprendre comment les structures scolaires et académiques (de l’école maternelle à l’enseignement supérieur) ainsi que les divers établissements socio-éducatifs (lieux d’accueil de la petite enfance, protection judiciaire de la jeunesse, centres sociaux, accueils de loisir, maisons des jeunes et de la culture, maisons des habitants, lieux de prise en charge des personnes âgées, etc.) tentent, chacun à sa manière, de répondre à la problématique de la vulnérabilité du sujet à tous les âges de la vie et dans des contextes variés.
Bibliographie
Beneyto-Seoane, M., Collet-Sabé, J. & Naranjo-Llanos, M. (2023). School, families and community networking against early school leaving: theoretical tenets and learnings from a Catalan experience. In A. Khasanzyanova & E. Mutabazi (Eds), School, family and community against early school leaving. International perspectives (pp. 45-62). Peter Lang.
Brodiez-Dolino, A. (2016). Le concept de vulnérabilité. La Vie des Idées. Consulté à l’adresse https://laviedesidees.fr/Le-concept-de-vulnerabilite.html
Castel, R. (1991). « De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation. Précarité du travail et vulnérabilité relationnelle. », dans Donzelot J. (dir.), Face à l’exclusion. Le modèle français. Esprit.
Cedelle, L. (2008). Un plaisir de collège. Le Seuil.
Delor, F., & Hubert, M. (2000). Revisiter la notion de vulnérabilité. Bulletin de la Société de pathologie exotique, 93(3), 238-246.
Dubasque, D. (2019). Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique. Presses de l’EHESP.
Erikson, E. H., Erikson, J. M., & Kivnick, H. Q. (1986). Vital Involvement in Old Age. Norton & Company.
Gevrey, V. (2021a). Les enseignants face à l’inquiétante altérité : étude clinique d’un rapport à l’Autre-élève en situation de grande pauvreté. La Nouvelle Revue Éducation et société inclusives, n°91, 2021/5, pp. 81-94.
Gevrey, V. (2021b). Penser le vécu psychique scolaire adolescent à partir de l’expérience groupale : étude clinique du décrochage scolaire à partir du discours adolescent. Nouveaux Cahiers de la Recherche en Éducation, vol. 23, n°1, pp. 127-148.
Goudeau, S. (2020). Comment l’école reproduit-elle les inégalités ? Egalité des chances - Réussite - Psychologie sociale. PU Grenoble.
Henn-Pap, A. (2023). Measurement and educational good practices to fight against early school leaving in Hungary. In A. Khasanzyanova & E. Mutabazi (Eds), School, family and community against early school leaving. International perspectives (pp. 181-196). Peter Lang.
Khasanzyanova, A. & Mutabazi, E. (Eds). (2023). School, family and community against early school leaving. International perspectives. Peter Lang.
Kern, D., & Schmidt-Hertha, B. (2023). Developing competencies to cope with transitions in later life – particularities of learning offers for older adults. Journal of Theories and Research in Education, 18(2), 97-112. https://doi.org/10.6092/issn.1970-2221/15779
Lemieux, A. (1995). Gérontagogie. Presses de l’Université du Québec.
Léon C., Pin, S. & du Roscoät, E. (2017) « Étude de trois situations de vulnérabilité chez les personnes âgées de 55 à 85 ans en France », Populations vulnérables, 3, 73-95.
Mutabazi, E. (2020). La pandémie COVID19 remet-elle en question la citoyenneté des personnes vulnérables ? Recherches & Éducations, HS, 1-12. https://doi.org/10.4000/rechercheseducations.9351
Mutabazi, E. & Khasanzyanova, A. (Dir.) (2023). Accompagner et prévenir le décrochage scolaire. Le Bord de l’eau.
Mutabazi, E. (Dir.). (2025). Viser la justice éducative. Bruxelles, Peter Lang.
Nielsen, J. (2023). Collaboration between schools, families and associations in Denmark: early intervention and interdisciplinary approach. In A. Khasanzyanova & E. Mutabazi (Eds), School, family and community against early school leaving. International perspectives (pp. 197-213). Peter Lang.
Ott, L. (2017). Principes élémentaires de la pédagogie sociale. Journal du droit des jeunes, N°361-362(1), 68-72. https://doi.org/10.3917/jdj.361.0068.
Peterson, D. A. (1976). Educational Gerontology. Jossey-Bass.
Ponsard, C. (2012). La scolarisation des élèves présentant des difficultés psychologiques à l’expression comportementale : l’école à l’ITEP, l’ITEP à l’école. Enfances & Psy, éres, 1(54), 92-101.
Van Zanten, A. (2010). L’ouverture sociale des grandes écoles : diversification des élites ou renouveau des politiques publiques d’éducation ? Sociétés contemporaines, 79(3), 69-95.
Viaud, M.-L. (2005). Des collèges et des lycées différents. PUF.
Inscription
Mercredi 28 Janvier 2026
UCO Angers - amphi Bedouelle
8h30
Accueil des participants
9h30
Mot d'accueil de Laurent PÉRIDY, Recteur de l'UCO, et Nathanaël WALLENHORST, Doyen de la faculté d'Éducation
9h45
Présentation et ouverture du colloque
10h30
Conférence plénière par Fred POCHÉ (UCO Angers) : « Que faire de la vulnérabilité ? »
12h00
Pause déjeuner
UCO Angers - salles IC301, 302, 303, 203, amphi Bedouelle
13h30 - 15h30
ATELIERS EN PARALLÈLE
Atelier 1 - Axe 2 : Vulnérabilités adolescentes dans et hors l'école - salle IC 301
Ludovic AUBIN (UCO Angers) : « Vulnérabilité psychologique des étudiants : facteurs sociaux et psycho-sociaux. Pistes de réflexion et expériences innovantes »
Albina KHASANZYANOVA (UCO Nantes) : « Le dispositif d'étudiants ambassadeurs comme une stratégie d'inclusion sociale et d'accès à l'enseignement supérieur des étudiants en situation de vulnérabilité »
François LE CLÈRE (Université Paris 8) : « Le dispositif pédagogique : entre vulnérabilités anticipées et vulnérabilités mises sous silence »
Stéphanie QUIRINO CHAVES (Université de Caen Normandie) : « Parcours de scolarisation et de formation, obstacles et ruptures : exemples à travers l'étude de parcours de jeunes présentant des troubles anxieux et dépressifs »
Atelier 2 - Axe 2 : Vulnérabilités adolescentes dans et hors l'école - salle IC 302
Sylvie BEAUMONT (Université Paris 8) : « L'accompagnement des jeunes Mineurs Non Accompagnés : de la vulnérabilité du sujet à la vulnérabilité du lien éducatif »
Patricia MOTHES (Institut Catholique de Toulouse / LIRFE / EFTS) : « De Illegal à Los nadie : l'enfant migrant vu par la littérature de jeunesse : vulnérabilité ou vulnérabilisation ? »
Marie Fernanda GONZALEZ BINETTI (Institut Catholique de Paris) : « Éduquer au cosmopolitisme : pour une citoyenneté active »
Vincent GEVREY (Institut Catholique de Toulouse / CIRCEFT / LIRFE) : « L'inclusion scolaire rend-t-elle les acteurs vulnérables ? »
Atelier 3 - Axe 3 : Vulnérabilités transitoires à l'âge adulte - salle IC303
Mahoutondji Olympe AGBANGLO (Régie des Quartiers d'Angers) : « Réduire la vulnérabilité sociale, professionnelle et citoyenne : l'expérience de la Régie de Quartiers d'Angers »
Vincent CHAUDET (ARIFTS Pays de la Loire / LIRFE) : « Intrications de vulnérabilités en travail social. Quand l'agent vulnéraire est lui-même vulnérable »
Claire MICHEL (Université de Tours) : « Relever le défi de la complexité au sein du travail social à partir du pouvoir d'entendre les vulnérabilités pour favoriser la résilience du sujet contemporain »
Maurine PERON (AFEV 49) : « La création de liens intragénérationnels comme levier face aux vulnérabilités sociales et éducatives »
Atelier 4 - Axe 3 : Vulnérabilités transitoires à l'âge adulte - salle IC203
Robert Messanh AMAVI (CIRNEF) : « "Cités Éducatives Euroises" : une politique publique territorialisée et holistique de mise en mouvement »
Ludovic GAROFALO (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) : « Les entrepreneurs contraints de la prison des Baumettes »
Alexandra CLAVÉ-MERCIER (UCO Angers / CITERES) : « Accompagner autrement des personnes en situations de grande vulnérabilité économique et sociale : la mobilisation des savoirs expérientiels »
Cécile LACÔTE-COQUEREAU (UCO Angers) : « Vulnérabilité du silence : quels dispositifs funambules pour entendre la voix de ceux qui ne parlent pas ? »
Symposium - Vulnérabilité des jeunes en formation - amphi Bedouelle
Nadia BAATOUCHE (UCO Angers / Cnam), Laurence BERNARD TANGUY (UCO Angers), Laurence COCANDEAU-BELLANGER (UCO Angers / Cnam) et Paul DU MESNIL DE MARICOURT (UCO Angers) : « Un dispositif réflexif d’accompagnement des étudiants au sens des études »
Aurélie BAYEN-POISSON (UCO Pacifique) et Adeline HULIN (UCO La Réunion) : « Faire face aux vulnérabilités étudiantes en contexte ultramarin : entre obstacles et leviers d'inclusion »
Laurence COCANDEAU-BELLANGER (UCO Angers / Cnam), Valérie COHEN-SCALLI (Cnam), Karine TERRADE-CHATARD (Cnam), Katia TERRIOT (Cnam) et Emmanuelle VIGNOLI (Cnam) : « Entre espoir, fierté et détresse émotionnelle, l'impact émotionnel différencié de Parcoursup sur les élèves de terminale lors de la transition vers l'enseignement supérieur »
15h30
Pause café
15h45 - 17h45
ATELIERS EN PARALLÈLE
Atelier 5 - Axe 2 : Vulnérabilités adolescentes dans et hors l'école - salle IC301
Emmanuelle DAVODEAU (DDEC 44) : « La MIJEC face à la vulnérabilité scolaire des jeunes : de l'absentéisme perlé au décrochage »
Karine GAUJOUR (Laboratoire CRSEA-CUCDB / ISFEC Grand Est) : « Récits de vulnérabilités éducatives : trajectoires d'élèves face au risque de décrochage scolaire »
Yves REUTER (Université de Lille) : « L'abandon comme modalité de la vulnérabilité scolaire »
Stéphanie VOUTEAU DOUET (CY Cergy Paris Université) : « "Joki Boost" : un dispositif d'accompagnement pour prévenir le décrochage scolaire en lycée professionnel »
Atelier 6 - Axe 2 : Vulnérabilités adolescentes dans et hors l'école - salle IC302
Henrik EDGREN (Uppsala University, Suède) : « Vulnérabilités, citoyenneté et post-Christianisme : une comparaison entre les modes d'enseignement de la citoyenneté en Suède et en France »
Jean Paul NIYIGENA (Université Catholique de Louvain, Belgique) : « La prise en charge de la vulnérabilité multidimensionnelle des enfants de filles-mères scolarisés à l'école communautaire de Zaza au Rwanda : pratiques et défi »
Eric MUTABAZI (UCO Angers) : « Vulnérabilité des élèves issus de l'immigration et éducation à la citoyenneté : le rôle des langues maternelles en Suède »
Emma LAURIN (Stockholm University, Suède) : « School Withdrawal and Vulnerability in Sweden: A Study of Families' Experiences, Educational Policy and Methods »
Atelier 7 - Axe 3 : Vulnérabilités transitoires à l'âge adulte - salle IC303
Sandra CADIOU (UCO Niort) : « Vulnérabilité du chef d'établissement en lycée agricole privé. Le cas de Rabi »
Christine JOLIVET-LEGRET (AICLA) : « Les cafés au village comme espace de parole et de dévoilement des fragilités dites "ordinaires" »
Marion DELAMOTTE (AICLA) : « L'agir collectif autour d’un projet concret comme médiation de la vulnérabilité »
Roseline COUPEAU (AICLA) : « Le bénévolat comme parcours de reconstruction post-vulnérabilité »
Atelier 8 - Axe 4 : Vieillissement, transmission et engagement - salle IC203
Florence BRONNY (Syndicat National d'Union des Psychomotriciens) et Marion PAGGETTI (CESI) : « Accompagner "par corps" un dépassement de la vulnérabilité : le cas des psychomotriciens en gériatrie pendant la crise sanitaire »
Manon AUSSILLOU BOUREAU (Université Toulouse - Jean Jaurès) : « Le tiers-espace socio-scientifique d'une recherche-intervention : rencontres, conscientisation et émergence des savoirs en EHPAD »
Alexis BOURGET (Petits Frères des Pauvres) : « Vulnérabilités et vieillesse : Comment avancer collectivement vers une société plus solidaire ? »
Corinne BAUJARD (Université de Lille) : « Expérience artistique et qualité de vie des personnes accueillies en EPHAD »
Symposium - Vulnérabilité des jeunes en formation - amphi Bedouelle
Nadia BAATOUCHE (UCO Angers / Cnam), Angel EGIDO PORTELA (UCO Angers / Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire) et Isabelle PICHON (UCO La Réunion) « La vulnérabilité étudiante : Comparaison France Togo, une analyse quantitative »
Gilles PINTE et Frédéric PUGNIÈRE-SAAVEDRA (tous Université Bretagne Sud) : « Quelle inclusion pour les étudiants-aidants à l'université ? »
Jeudi 29 Janvier 2026
UCO Angers - salles IC301, 302, 303
8h30
Accueil des participants
9h00 - 11h00
ATELIERS EN PARALLÈLE
Atelier 9 - Axe 1 : Accueil et accompagnement dès le plus jeune âge - salle IC301
Dominique GILLET-CAZENEUVE (Université de Bordeaux) : « Des constats aux solutions : comment soutenir la subjectivité des enfants à l'école, quelques dispositifs d'écoute et de parole »
Héléna FRITHMANN (Université de Strasbourg ), Éric FLAVIER (Université de Strasbourg ) et Nathalie GAVENS (Université de Haute-Alsace) : « La collaboration interprofessionnelle entre éducateurs spécialisés et enseignants du premier degré : un pilier de la scolarité des enfants placés en Protection de l'Enfance »
Antoine LEMONNIER, Christelle LECELLIER et Céline ROY (tous SESSAD APF France Handicap) : « Accompagner l'enfant et ses parents en SESSAD : une approche pluridisciplinaire pour soutenir les ressources de l'enfant… »
Atelier 10 - Axe 2 : Vulnérabilités adolescentes dans et hors l'école - salle IC302
Marie BORG-OLIVIER (UCO Angers) : « Vulnérabilités éducatives d'adolescents issus de familles atypiques : un atelier réflexif »
Gabin BROUARD (Apprentis d'Auteuil) : « Vulnérabilité et inclusion des Mineurs Non Accompagnés : l'expérience d'Apprentis d'Auteuil »
Stéphane HÉAS (Université Rennes 2) et Patrice RÉGNIER (UCO BS) : « Vulnérabilités potentielles en EPS : les usages de certificats médicaux et des mots parentaux aujourd'hui »
Nassim KHIDACHE (UCO Angers) : « Le dispositif d'aide aux devoirs dans les associations comme instance d'intervention auprès des élèves vulnérables »
Atelier 11 - Axe 3 : Vulnérabilités transitoires à l'âge adulte - salle IC303
Amélie ALLETRU (UCO Angers / CREN) : « Des situations d'enseignement "à risque" : La redéfinition des objets de savoir au prisme du sentiment de vulnérabilité »
Dominique MORANDEAU (UCO Angers / INDE) : « La vulnérabilité de l'enseignant à l'ère de la post-modernité : lecture au prisme du triangle de Houssaye »
Gérald HOUDEVILLE (UCO Angers / CENS / Centre Émile Durkheim) : « De jeunes vulnérabilisés en service civique, la confrontation des temps »
11h00
Pause café
UCO Angers - amphi Bedouelle
11h15
Conférence plénière par Chiara PESARESI (Université Catholique de Lyon): « La vulnérabilité, entre crise et confiance »
12h30 - 14h00
Pause déjeuner
UCO Angers - salles IC301, 302, 303, 203
14h00 - 15h30
ATELIERS EN PARALLÈLE
Atelier 12 - Axe 1 : Accueil et accompagnement dès le plus jeune âge - salle IC301
Dominique LAHANIER-REUTER (Université de Bordeaux) : « Vulnérabilité des élèves en situation de grande pauvreté »
Virginie LIOT (Université Lumière Lyon 2) : « Entre représentations sociales et droit à l'éducation : la scolarité à l'épreuve des maladies rares »
Véronique MOTARD (UCO Angers) : « La vulnérabilité : enjeux et pratiques à l'école primaire »
Atelier 13 - Axe 1 : Accueil et accompagnement dès le plus jeune âge - salle IC302
Jennifer KERZIL (UCO Angers) : « La vulnérabilité des enfants confiés à l'ASE face à l'institution scolaire et aux apprentissages »
Véronique SIMON (Uppsala University, Suède) : « Children's and parents' vulnerability in the Swedish preschool, in a migration context »
Asano YOSHIKO (Japan Women’s University, Japon) : « Non-native children and parents in the Japanese preschool: how to address a vulnerable group »
Atelier 14 - Axe 2 : Vulnérabilités adolescentes dans et hors l'école - salle IC303
Rémi POYMIRO (Université de Bordeaux) : « "Ces élèves qui nous inquiètent en classe" : une approche de la régulation du climat de classe au service de la prise en compte des vulnérabilités »
Marie LE BEC (Université de Bordeaux) : « Contractualiser l'aide permet-elle de lutter contre la vulnérabilité ? »
Catherine NAFTI-MALHERBE (UCO Angers) : « Approche socio-historique du concept de vulnérabilité : quels impacts sur les politiques publiques de prise en charge de 1945 à nos jours »
Atelier 15 - Axe 2 : Vulnérabilités adolescentes dans et hors l'école - salle IC203
Jean-François POULELAOUEN (Le Mans Université / Vyv3 Pays de la Loire / CREN) : « Exister dans et par l'école : la participation sociale, levier de justice contre les vulnérabilités invisibles »
Agnès TEYNIÉ (UCO Angers) : « Un dispositif d'accompagnement de jeunes adultes vivant des vulnérabilités existentielles et académiques en dialogue avec l'éthique du care »
Alexandra SOLAZZO (EPIDE) : « L'EPIDE : un tremplin pour l'insertion des jeunes en situation de vulnérabilité »
- Hérode Alexandre (étudiant en master sciences de l’éducation)
- Marine Aubin (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Justine Beucher (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Anne Bres (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Anne-Claire Cerisier (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Bastien Delahaye (étudiant en master sciences de l’éducation)
- William Diallo (étudiant en master sciences de l’éducation)
- Vincent Dionisio (étudiant en master sciences de l’éducation)
- Anne-Valérie Durand (UCO Angers)
- Mathilde Foschia (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Jehanne-Marie Fraval de Coatparquet (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Vincent Gevrey (Institut Catholique de Toulouse / CIRCEFT / LIRFE)
- Jacques Hakizimana (étudiant en master sciences de l’éducation)
- Chloé Lécolier (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Raimata Marmouyet (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Angèle Paillat (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Émilie Perrais (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Axel Plâtre (étudiant en master sciences de l’éducation)
- Marie-Claude Tonnel (enseignante)
- Johana Verdol (étudiante en master sciences de l’éducation)
- Yamina Bouchamma (Université Laval, Canada)
- Vincent Chaudet (ARIFTS Pays de la Loire / LIRFE)
- Henrik Edgren (Uppsala University, Suède)
- Marc-André Éthier (Université de Montréal, Canada)
- Vincent Gevrey (Institut Catholique de Toulouse / CIRCEFT / LIRFE)
- Bruno Hubert (Université de Lille)
- Mickaël Idrac (Université de Liège, Belgique)
- Véronique Kannengiesser (Université de Picardie Jules Verne / INSPE d'Amiens)
- Magdalena Kohout-Diaz (Université de Bordeaux)
- Dominique Lahanier-Reuter (Université de Bordeaux)
- Rakia Laroui (Université du Québec à Trois-Rivières, Canada)
- David Lefrançois (Université du Québec en Outaouais, Canada)
- Patricia Mothes (Institut Catholique de Toulouse / LIRFE / EFTS)
- Jean Paul Niyigena (Université Catholique de Louvain, Belgique)
- Hugues Pentecouteau (Université Rennes 2)
- Alexandre Ployé (CY Cergy Paris Université)
- Yves Reuter (Université de Lille)
- Véronique Simon (Uppsala University, Suède)
- Stellan Sundh (Uppsala University, Suède)
- Rachel Solomon Tsehaye (Université de Fribourg, Suisse)





