LIRFE
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Questions Vives en Formation et en Éducation
LIRFE
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Questions Vives en Formation et en Éducation
Le LIRFE est un laboratoire de recherche interdisciplinaire, ancré en sciences de l’éducation et de la formation, qui se donne pour objet les questions vives concernant son champ.
La formulation « questions vives » ne désigne pas un ensemble d’objets prédéterminés. Il s’agit d’investir prioritairement des questions et des problèmes qui peuvent se poser dans la société et/ou en termes de controverses entre spécialistes et entre experts. Ces questions sont – et restent – vives au-delà de la seule actualité, tant qu’elles ont une dimension problématique, dimension qui peut être durable. Un certain nombre d’objets peuvent déjà être mentionnés, sans exhaustivité. On peut évoquer, par exemple, les questions, déjà au travail chez les chercheurs qui se proposent de participer à ce laboratoire, liées à l’entrée dans l’Anthropocène, au phénomène de l’accélération et à la résonance (Rosa), à la perspective de l’homme augmenté, à la culture numérique, à la citoyenneté dans une société de l’individualisme et du consumérisme, à la vulnérabilité et aux risques notamment liés à l’évolution des conditions de travail et de l’identité professionnelle.
Les questions vives évoquées peuvent avoir une dimension sociétale, culturelle, technologique, anthropologique ou autre. Ce qui les caractérise, c’est qu’elles s’imposent et dans le vivre ensemble et dans le débat public et qu’elles jouent un double rôle dans la formation et dans l’éducation : en tant qu’elles ont un effet sur celle-ci (pensons par exemple à la révolution numérique qui modifie la disposition attentionnelle des élèves et des étudiants), et en tant qu’elles sont l’objet de celles-ci (une formation numérique est ainsi intégrée aux cursus scolaires et universitaires).
Le projet scientifique du laboratoire est, sur ces questions vives, de :
- Décrire scientifiquement les objets, les dispositifs, les phénomènes qui posent des questions vives (par exemple : qu’est-ce qui détermine l’Anthropocène comme âge géologique ? quels sont les effets d’un implant cochléaire ? quelles sont les pratiques parentales eu égard aux dispositifs numériques ?)
- Travailler à préciser et délimiter les concepts utiles pour penser les questions vives évoquées (par exemple qu’est-ce que le « virtuel » ? comment définir la « présence » ?).
- Croiser les approches disciplinaires, et notamment les sciences de l’éducation et de la formation avec la psychologie, les neurosciences et les sciences de l’information et de la communication (exemple d’objet sollicitant une approche interdisciplinaire : quelle est la nature des apprentissages qu’un enfant peut faire dans une expérience d’immersion en réalité virtuelle ?).
- Pratiquer des recherches de terrain, notamment auprès des acteurs concernés, et à chaque fois que possible, dans le cadre de recherches collaboratives avec ces acteurs (par exemple dans les établissements scolaires, en formation continue et à l’université). Les enjeux de cette dimension collaborative sont multiples : épistémologique (co-construction de savoirs), praxéologique (objectif de développement professionnel et d’adaptation de la formation), méthodologique (mode de recueil des données et de restitution) et éthique (respect de la parole du sujet).
L’enracinement du laboratoire en sciences de l’éducation et de la formation est orienté en double sens. Il s’agit de s’intéresser aux questions qui se posent de facto en éducation et en formation (par exemple, quelle place donner aux dispositifs numériques des étudiants en cours à l’université ?). Mais il s’agit aussi de s’intéresser à des questions vives qui se posent de façon indépendante (par exemple, l’entrée dans l’Anthropocène et sa signification en termes de mode de vie), et sur lesquelles on peut aussi s’interroger du point de vue éducatif (faut-il responsabiliser ou rassurer les enfants ?). Enfin, les termes « éducation » et « formation » visent à recouvrir tous les âges de la vie et tous les modes d’apprentissage (formels et informels, institutionnels et familiaux, individuels et collectifs).

Le LIRFE repartit ses recherches en trois axes
1.Altérite, vulnérabilité et citoyenneté (AVC)
Responsable de l’axe : Eric MUTABAZI
Dans cet axe de recherche, il s’agit de traiter la question de la place faite en éducation, en formation et dans l’enseignement, à l’altérité, à la vulnérabilité dans la perspective de la construction de la citoyenneté. L’objectif est de soutenir les travaux de recherche individuels et collectifs portant globalement sur ces problématiques de recherche, notamment la justice éducative, les inégalités sociales et culturelles, l’interculturalité, l’éducation à la citoyenneté, le décrochage, l’inclusion dans et hors les murs scolaires (de la maternelle à l’université). Les recherches menées s’intéresseront notamment aux dispositifs, méthodes, etc., qui portent une attention particulière à différentes populations en situation de vulnérabilité (handicap physique, enfants mineurs non-accompagnés, personnes de la rue, les adultes en situation d’illettrisme, élèves – allophones, décrocheurs, en difficulté d’apprentissage, issus de quartiers sensibles ou issus de l’immigration, etc.).
2. Circulation des savoirs et pluralité des acteurs et actrices
Responsable de l’axe : Sophie Joffredo-Le Brun
L’axe circulation des savoirs et pluralité des acteurs et actrices accueille des enseignants-chercheurs en sciences de l’éducation et de la formation issus de différents champs disciplinaires. Citons entre autres la sociologie, l’histoire, la psychologie cognitive, les neurosciences, la psychanalyse, la didactique professionnelle et comparée.
Cet axe se donne comme programme de recherche de décrire, comprendre, analyser et modéliser des situations éducatives, qu’elles soient d’enseignement ou de formation dans le champs scolaire (de l’école maternelle à l’université) ou extra-scolaire. Une focale sera portée sur l’étude de la transmission, l’appropriation et de la circulation des savoirs entre acteurs éducatifs. Les terrains investigués peuvent être multiples et regrouper des acteurs et actrices tels que des membres d’équipes pédagogiques, (professeur.e.s, formateur.rice.s...), d’équipes éducatives (psychologue, AESH, ATSEM, CPE...), de cadres scolaires (chefs d’établissement, IEN, IA-IPR...), de personnels associatifs etc.
La thématique de l’émancipation peut être un fil conducteur aux différents travaux de recherche sur la circulation des savoirs inter et intra catégoriels. Les recherches collaboratives/participatives peuvent être une entrée méthodologique, épistémologique et théorique pour ces études. Différents paradigmes méthodologiques et méthodes qualitatives et quantitatives se côtoient et se complètent.
3. L’éducation en Anthropocène (EEA)
Responsable de l’axe : Nathanaël WALLENHORST
Depuis 40 ans l’éducation au développement durable permet de sensibiliser à la nature et l’environnement, elle est un support de l’éducation scientifique et accompagne l’entrée dans la citoyenneté. Mais la question se pose de savoir si, avec la possible perspective d’une véritable rupture dans l’équilibre du système Terre, il n’est pas nécessaire de recourir à un autre concept que celui du développement, avec celui d’Anthropocène. Ce dernier serait susceptible de permettre de penser la complexité des phénomènes en cours, l’interdépendance des différentes formes de vie, la discontinuité de l’avenir qui se profile et la dimension politique que cela implique. Le paradigme principal de l’Anthropocène est précisément la rupture, dissonant avec le paradigme linéaire et continuiste dominant qui organise le corpus des savoirs scolaires disciplinaires. Les savoirs de l’Anthropocène pourraient être porteurs d’une transformation paradigmatique dans l’appréhension du monde sur le plan cognitif (dans l’appréhension de la complexité du réel) comme sur le plan politique, en tant que puissance mobilisatrice. Les travaux des chercheurs de cet axe explorent la mobilisation de cet outil conceptuel dans le champ des sciences de l’éducation et de la formation.
Le savoir est là (dans les articles scientifiques, les bibliothèques et les rapports du Giec – et accessible à portée de clic sur le web) mais il échappe encore en grande partie aux citoyens. Nous avons affaire à un paradoxe éducatif aux conséquences sociétales qui fait l’objet d’une mise au travail par les chercheurs de cet axe, autour d’une problématisation éducative qui mobilise tout à la fois des savoirs issus des sciences exactes, des sciences sociales et de la science politique. Dans Qu’est-ce que les Lumières ? (1784), Emmanuel Kant appelle les êtres humains à avoir le courage de savoir, sortir de la minorité, et faire un usage public de la raison. Ce sont les enjeux de fonds auquel cet axe s’attèle. Ce courage de savoir est une sortie résolue de l’état de tutelle et d’immaturité dans laquelle sont les citoyens et dont ils sont individuellement responsables : « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! » (Sapere aude !). L’enjeu est alors que les citoyens entrent dans la « majorité » (Mündigkeit), soient capables de raisonner par eux-mêmes, de façon éclairée, sans suivre leurs guides politiques. Mais Kant précise aussi que la sortie individuelle de la minorité ne va pas de soi. Il est ici nécessaire de faire un usage public de la raison grâce à la liberté de publication. Si l’enjeu de la fin du 18ème siècle était celui de la liberté d’accès aux savoirs (ils étaient cachés ou censurés), celui du début du 21ème est celui de leur identification (ils sont dilués dans un ensemble où les savoirs scientifiques côtoient les mensonges climatosceptiques), de leur compréhension (les savoirs sont caractérisés par leur complexité) et de leur traduction politique (ils appellent l’exercice d’un jugement politique pour discerner ce qui conduit dans une impasse de ce qui permet la pérennité de la vie humaine en société).
La conceptualisation de l’Anthropocène tente de faire avancer le front de sciences en sciences de l’éducation et de la formation à deux niveaux :
- 1er niveau. En mobilisant l’Anthropocène à partir du débat stratigraphique et systémique cela fait apparaître le paradigme unificateur de ces savoirs qui est la rupture. Or, l’ensemble du corpus des savoirs scolaires est organisé autour d’un paradigme linéaire. Ce constat est important : il signifie que ce ne sont pas seulement les logiques économiques capitalistes et croissantistes qui ne s’encastrent pas dans le réel biogéophysique, mais aussi l’ensemble de nos pratiques et conceptions éducatives. Cela implique que le champ des sciences de l’éducation et de la formation est à refonder sur d’autres socles paradigmatiques à construire. En effet, les pratiques éducatives puis la pensée éducative sont la résultante de l’entrée dans la précédente époque géologique, l’Holocène, dont la stabilité et la prévisibilité bioclimatique a rendu possible la maîtrise des écosystèmes et la possibilité de dégagements d’excédents agricoles qui ont abouti à l’émergence des civilisations. L’entrée dans une nouvelle époque géologique caractérisée par une modification des conditions bioclimatiques d’existence amène avec elle des ruptures épistémologiques profondes (aussi conséquentes que celles qui ont permis l’éducation). C’est un champ disciplinaire qui est à refonder à partir d’une nouvelle épistémè (la rupture).
- 2ème niveau. Le travail de vulgarisation des données biogéophysiques et sociopolitiques relatives au contexte bioclimatique conduit à la production d’un savoir scientifique propre au champ des sciences de l’éducation en simplifiant la complexité de l’Anthropocène pour la rendre intelligible et sensible. L’Anthropocène est présenté comme la résultante des trois grands ensembles organisateurs du système Terre (le climat, la biosphère et les sociétés) et de leurs processus respectifs : le climat s’emballe, les écosystèmes de la biosphère s’effondrent et les sociétés accélèrent. Émerge alors un chantier de redéfinition de l’éducation et de la pédagogie compte-tenu des réquisits de l’Anthropocène.
Dernières publications

Actualités

Colloque international | 13-14 Avril
Éduquer et former à et par la confianceColloque international organisé par le campus UCO BS à Vannes en partenariat avec Apprentis d'Auteuil et la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique du Morbihan (DDEC 56). |

Colloque | 19-20 Mars
L'idée d'université aujourd'huiColloque organisé dans le cadre des 150 ans de l'UCO. |

Soutenance de thèse | 4 Mars
L'éducation Démocratique des élèves à l'école Montessori de Yaoundé (Cameroun) : Entre modes traditionnels de gouvernement et apprentissages de la démocratie. Analyse d'une hybridation ethnoculturelleSoutenance de thèse de Joseph Bertin BEBOULA NOAH dans le cadre du doctorat ECE (Éducation, Carriérologie et Éthique). |

Dej'Recherche | 26 Février
Le nudge administratifUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 17 Février
Généalogie de la justice socialeUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 5 Février
Crises institutionnelles, insécurité et recompositions autoritaires dans les Andes : regards croisés sur le Pérou, la Bolivie et l'ÉquateurUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Colloque international | 28-29 Janvier
Vulnérabilité du sujet à tous les âges de la vieColloque international organisé par l'équipe de recherche LIRFE (Faculté d'Éducation), en lien avec le projet de recherche UCO « ECISC ». |

Dej'Recherche | 13 Janvier
Jeunesse et changement climatique : l'éco-anxiété, un levier indispensable de l'éco-responsabilité et de l'engagement environnemental ? Une comparaison France Etats-UnisUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 4 Décembre
Behavioural and electrophysiological (ERP) determinants of decision-making in individuals with a smoking habitUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Colloque international | 24 Novembre
La rencontre des peuples : tension féconde et dons mutuels entre la foi chrétienne et la culture vietnamienneColloque international organisé dans le cadre des 150 ans de l'UCO, en partenariat avec l'Institut d'Histoire des Missions (Institut Catholique de Paris) et l'Institut Catholique du Vietnam (ICV), et avec le soutien de l'association Les Amis de Van. |
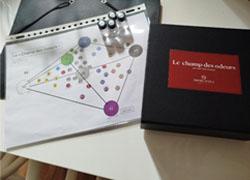
Séminaire | 10, 11, 24 et 25 Octobre
Séminaire olfactionSéminaire de l'équipe de recherche LIRFE (Faculté d'Éducation). |

Journée d'étude | 17 Octobre
Comment accompagner en sciences de l'éducation à l'ère de l'Anthropocène ?Journée d'étude organisée par l'équipe de recherche LIRFE (Faculté d'Éducation) en partenariat avec le laboratoire LIRTES (Université Paris-Est Créteil). |

Dej'Recherche | 6 Mai
Dej'PépitePrésentation des pépinières de recherche et avancements des projets en collaboration avec les étudiants. |

Dej'Recherche | 22 Avril
Le jeu chez l'enfant traumatiséUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 8 Avril
Titre à venirUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Colloque international | 19-21 Mars
La direction scolaire dans tous ses étatsColloque international organisé par l'équipe de recherche LIRFE (Faculté d'Éducation), en lien avec le projet de recherche UCO « AEEC ». |

Dej'Recherche | 18 Mars
Gestion du Temps et Bien-Être des Doctorants : Une Étude Qualitative du Sentiment de CulpabilitéUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 12 Mars
Savoirs sur le lointain et production du territoire : la construction de l'Etat péruvien depuis ses confins amazoniens (1919-1930)Un exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 18 Février
La carte de TupaïaUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Soutenance de thèse | 16 Décembre
Impacts scolaire et non scolaire de l’intervention psychomotrice sur les troubles des compétences praxiques et graphiques chez les enfants à haut potentiel intellectuel (H.P.I.) de type hétérogène entre 6 et 10 ansSoutenance de thèse de Séverine ALONSO-BEKIER dans le cadre du doctorat ECE (Éducation, Carriérologie et Éthique). |

Dej'Recherche | 3 Décembre
Transmission intergénérationnel, fiscalités et différences de productivités dans un cadre théoriqueUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Journée d'étude | 28 Novembre
L’olfaction au cœur de l’humain, la place du sentir dans les sciences humaines et socialesJournée d'étude de l'équipe de recherche LIRFE (Faculté d'Éducation) organisée en partenariat avec l'Université Toulouse - Jean Jaurès. |

Dej'Recherche | 26 Novembre
Dej'PépitePrésentation des pépinières de recherche et avancements des projets en collaboration avec les étudiants. |

Dej'Recherche | 12 Novembre
Technologies XR en Recherche et InterventionsUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 22 Octobre
Colère, anxiété et préférences pour la redistribution des richessesUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 8 Octobre
Apports de la psychopathologie cognitive dans le traitement des TOCUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Soutenance de thèse | 23 Août
La pensée complexe d'Edgar Morin et la pédagogie sociopolitique de Paulo Freire : un lien possible en tant que fondements méthodologiques actifs allié à l’usage critique de technologies numériquesSoutenance de thèse de Patricia FLEURY dans le cadre du doctorat ECE (Éducation, Carriérologie et Éthique). |

Dej'Recherche | 16 Avril
Étude des homicides conjugaux au Québec : méthodologie, collecte et résultatsUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Soutenance de thèse | 11 Mars
Quelles places pour la coordination motrice dans l’évolution de la lecture chez les enfants dyslexiques en école élémentaire ?Soutenance de thèse d'Aurélie LAVIGNE BONNIFET dans le cadre du doctorat ECE (Éducation, Carriérologie et Éthique). |

Dej'Recherche | 28 Février
Bridging minds and markets: exploring the neuroeconomic frontierUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 13 Février
Titre à venirUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Colloque international | 30-31 Janvier
Penser les pratiques inclusives, dans et hors les murs, de l’école à l’université : enjeux sociaux, politiques et éducatifsColloque international organisé par l'équipe de recherche LIRFE (Faculté d'Éducation) dans le cadre du projet de recherche Erasmus+ « DIPLOMA ». |

Dej'Recherche | 30 Janvier
Rechercher en enseignement en olfaction : enjeux, difficultés, intérêts, exemplesUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Journée d'étude | 30 Janvier
Journée d'étude du projet « SEVE » (Sens des Etudes et Vulnérabilité des Etudiants) : regards croisés sur le sens et la vulnérabilité des jeunesJournée d'étude de l'équipe 2S2T (Faculté SHS) organisée dans le cadre du projet UCO « SEVE » (Sens des Etudes et Vulnérabilité des Etudiants). |
Projet national
Anthropo-cène-scolaire : L'école à l'épreuve de l'Anthropocène ?Financement ANR PRC En partenariat avec Université de Caen Normandie, Aix-Marseille Université, Université de Montpellier, Université Côte d'Azur Cette recherche a pour point de départ un constat paradoxal qui permet de questionner les rapports que l'École entretient avec les sociétés contemporaines : il est aujourd'hui question d'Anthropocène presque partout, sauf à l'École pourtant censée préparer les jeunes générations aux défis de demain. Le projet étudie donc la présence ou l'absence du concept d'Anthropocène comme de ses attributs, à partir des débats scientifiques pluridisciplinaires complexes et contradictoires. Il prend pour objet les curricula de l'éducation au changement climatique (ECC), au développement durable (EDD), à la biodiversité (EB), aux questions socialement vives (EQSV), morale et civique (EMC) à partir d'une analyse curriculaire portant sur des enseignements disciplinaires identifiés (HGGSP, Histoire-géographie, SES, Physiquechimie, SVT). Le projet porte sur le lycée, moment où les élèves explorent les problématiques globales et entrent dans une compréhension approfondie de la complexité des phénomènes physiques et sociaux. |
Projet international
STEM AdvocatesFinancement Erasmus+ En partenariat avec Universitaet zu Köln (Allemagne), Universitat Wien (Autriche) Ce projet a pour objectif d'encourager l'intérêt pour les domaines STEM (sciences, technologies, ingénieries et mathématiques) en abordant conjointement trois domaines clés : l'orientation professionnelle, la préparation aux études et une image positive de soi sur le plan académique. Il se concentre sur la transition entre l'école et l'université et renforce la collaboration entre les établissements d'enseignement. L'accent est mis sur l'encouragement des groupes actuellement sous-représentés. Le projet vise à favoriser l'engagement, l'autonomisation et l'inclusion dans l'enseignement des STEM et les parcours professionnels. |
Projet international
Rythmes de l'Anthropocène et mutations paradigmatiques en éducation environnementale au Brésil et en FranceFinancement Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brésil) En partenariat avec Universidade Federal do Rio Grande (Brésil), Observatório dos Conflitos Sócio-Ambientais do Extremo Sul do Brasil e Este del Uruguay, Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires Ce projet postdoctoral analyse l'émergence des notions de rythme et de catastrophe dans les processus de formation des éducateurs et éducatrices en éducation environnementale au Brésil et en France, ainsi que les mutations paradigmatiques à l'œuvre dans ce champ face au contexte de l'Anthropocène. |
Projet international
Éducation en Anthropocène | Education in the AnthropoceneEn partenariat avec Goethe-Universität Frankfurt am Main (Allemagne), Stockholms universitet (Suède), Universität Wien (Autriche), Università di Firenze (Italie) L'objectif de ce WERA-IRN (réseau international de recherche en éducation) est de faire progresser la recherche et les connaissances fondées sur la recherche dans le domaine des sciences de l'éducation, à la lumière de la transformation des conditions bioclimatiques à l'ère de l'Anthropocène, en s'efforçant de remodeler la pensée et la pratique éducatives sur la base de nouveaux paradigmes qui intègrent la réflexion cruciale sur l'Anthropocène. In collaboration with Goethe-Universität Frankfurt am Main (Germany), Stockholms universitet (Sweden), Universität Wien (Austria), Università di Firenze (Italy) The aim of this WERA-IRN (international research network in education) is to advance research and research-based knowledge in the educational sciences, in light of the transformation of bioclimatic conditions in the Anthropocene, by working to reshape educational thinking and practice on the basis of new paradigms that include the crucial thinking of the Anthropocene. |
Projet international
Apprentissage par les pairs à l'appui des transformations socioculturelles et technologiques | Peer Learning in Support of Socio-Cultural and Technological TransformationsFinancement Institut McGrath pour la vie de l'Église | Funding McGrath Institute for Church Life En partenariat avec Université Notre-Dame (USA) Ce projet de recherche-action se concentre sur le développement d'approches innovantes pour l’auto-formation d’adultes engagés dans des communautés ecclésiales, notamment par la conception d'infrastructures sociotechniques qui facilitent un apprentissage efficace entre pairs. In collaboration with University of Notre Dame (USA) This action-research project focuses on developing innovative approaches to leadership development for adults engaged in ministry, specifically through designing socio-technical infrastructures that enable effective peer learning. |
Projet national
DEEC : Détermination de l'efficacité d’une expérimentation contrôlée en enseignement-apprentissageFinancement ANR PRC En partenariat avec Université de Bretagne Occidentale Les objectifs du projet consistent à déterminer l’efficacité d’une séquence de classe, issue de la recherche en éducation, consacrée à la résolution-création de problèmes d’arithmétique, d’abord dans un environnement restreint, ensuite au sein d’un grand nombre de classes (50). |
Projet UCO | Projet classique
COMEEN : Communication et médiation écologique, éthique et numériqueEn partenariat avec INRAE, Université catholique de Louvain, Université de Limoges, Université Côte d’Azur Ce projet de recherche analyse les formes de médiation et de médiatisation liées aux transitions écologiques et numériques. Il interroge l’engagement écologique et les modes d’organisation durables et éthiques à partir des dispositifs de médiation, des usages et des stratégies. |
Projet UCO | Projet classique
SEVE : Sens des Etudes et Vulnérabilités des EtudiantsEn partenariat avec Université Bretagne Sud, Université Paris Nanterre, Université de Tunis El Manar (Tunisie), Université de Tunis (Tunisie), Université Virtuelle de Tunis (Tunisie) L’objectif principal de ce projet est de comprendre le sens des études et sa construction, du point de vue des étudiants de 1er cycle universitaire et au regard de leurs conditions d’existence. L’intérêt du projet tient dans ce qu’il ne sépare pas le rapport à la formation, au savoir, à l’apprentissage et au sens des études et de la vie des étudiants d’une part et les parcours et conditions d’existence de ces étudiants, notamment leur bien-être ou mal-être, leur fragilité éventuelle, leur vulnérabilité possible, leur santé physique et mentale, d’autre part.
|
Projet UCO | Projet Tremplin
AEEC : Adjoints d’Etablissement scolaire de l’Enseignement CatholiqueEn partenariat avec Université Rennes 2, Université de Haute-Alsace, Université de Lausanne (Suisse) L'objectif du projet AEEC est d'analyser l'activité des adjoints d’établissements scolaires de l'enseignement catholique en se focalisant sur les dimensions coopératives de leur travail en abordant : les logiques d’actions, les stratégies de contournement et la mise en œuvre des compétences socio-affectives. Cette analyse permettra aussi d’identifier les ressources (notamment éthiques) permettant le soutien émotionnel aux autres acteurs. Ce projet visera également à clarifier la spécificité de l’engagement de ces acteurs au regard du « caractère propre » de l’enseignement catholique et l’anthropologie chrétienne dans laquelle il s’inscrit. |
Projet UCO | Projet classique
CC : Sens et enjeux de la condition corporelle. Perspectives philosophiques et théologiquesLa condition corporelle est ce qui manifeste le plus fondamentalement notre dépendance à l’égard de l’écosystème biologique et humain, relationnel, familial, social et politique. Le projet CC a pour objectif de faire un nouvel état des lieux du sens de la condition corporelle pour envisager avec sérénité les défis anthropologiques, sociétaux, culturels et écologiques à venir. L’équipe du projet étudiera également la pertinence de la réalisation d’un Vocabulaire théologique du corps. |
Projet UCO | Projet classique
ECISC : Education à la Citoyenneté face aux Inégalités Sociales et CulturellesEn partenariat avec Université de Haute-Alsace, Université Bretagne Sud, Université Paris-Saclay, Université d’Uppsala (Suède), Université catholique de Louvain (Belgique), Université du Québec à Outaouais (Canada), Université de Montréal (Canada), École Normale Supérieure de Koudougou (Burkina Faso) L'objectif du projet ECISC est d’inviter les chercheurs issus de différents contextes et horizons à explorer la question de l’éducation à la citoyenneté face aux inégalités sociales et culturelles. En s’appuyant sur des méthodes empiriques (investigation sur le terrain) et des outils conceptuels, ce projet tentera de comprendre « comment préparer l’avenir des humains et des sociétés avec cette inégalité qui ne s’estompe pas, mais ne cesse de s’accroître surtout au cours de ces vingt dernières années (OCDE, 2015) et qui ne fait qu’exclure des personnes plus vulnérables ? » Plus particulièrement, la responsabilité de l’école dans la mise en œuvre de cette égalité sera interrogée. |
Projet international
Citizenship education and the challenge of cultural diversity for pupils in France and SwedenFinancement Association franco-suédoise pour la recherche En partenariat avec Uppsala University (Suède) L'objectif de ce projet est d'étudier les pratiques pédagogiques interculturelles au service de l'éducation à la citoyenneté et leurs effets dans un contexte similaire à celui de la France, à savoir la Suède. |
Projet national
CIPES : Choisir l'Inclusion Pour Eviter la SégrégationFinancement ATD Quart Monde Cette recherche-action a pour objectif d'expérimenter de nouveaux chemins avec et dans les écoles et collèges volontaires, afin d’en finir avec les orientations scolaires pour cause de pauvreté. |
Projet national
Coopération professeurs-chercheurs pour la compréhension et l'efficacité des pratiques d'enseignementFinancement DGESCO Ce projet s’efforce de contribuer à une meilleure compréhension des pratiques d’enseignement /apprentissage, et à la détermination de leur efficacité, en particulier pour les élèves moins avancés. |
Projet national
Evaluation du processus d’acquisition des savoirs et compétences des jeunes en difficulté scolaireFinancement Apprentis d’Auteuil En partenariat avec le collège de la Hublais (Cesson-Sévigné) Cette recherche-action s’intéresse à la pédagogie en cours de déploiement au collège de la Hublais auprès d’un public de jeunes en difficulté scolaire (décrocheurs). Il s’agit d’une évaluation du processus d’acquisition des savoirs et compétences des jeunes dans le cadre du projet d’établissement pour obtenir des données objectives traitées scientifiquement, pour dépasser les champs émotionnels et subjectifs et améliorer la pédagogie. |
Projet international
DIPLOMA : Development of Inclusive and Participatory Learning in Organisations through Multicultural AmbassadorsFinancement Erasmus+ En partenariat avec University of Suffolk (Royaume-Uni), Amasya Üniversitesi (Turquie), Universitatea din București (Roumanie), National Alliance of Student Organisations in Romania (Roumanie), Centrul de Proiecte Educationale si Sportive - PROEDUS (Roumanie) Ce projet a pour objectif de développer et intégrer de nouvelles approches de travail avec les étudiants ambassadeurs afin de leur donner les moyens de promouvoir des universités plus inclusives. Les étudiants ambassadeurs multiculturels, diversifiés et défavorisés ont la possibilité de travailler de manière inclusive avec des jeunes issus de milieux similaires, en les aidant à développer des connaissances, des compétences et des identités précieuses pour l'accès à l'enseignement supérieur et la progression. |
Programme UCO
P3AT : Préparation de l'avenir, anthropologie, anthropocène et transhumanismeLa préparation de l’avenir et l’hospitalité du monde pour les générations à venir est une responsabilité nouvelle qui nous incombe. Les contextes géologique, techno-scientifique et sociétal amènent un ensemble de questions anthropologiques et politiques : qui sommes-nous et qui voulons-nous devenir ? Comment préparer l’avenir ? Comment rendre le monde hospitalier pour les nouvelles générations ? Ce projet vise à formaliser une pensée responsable de préparation de l'avenir et de dialoguer avec les acteurs du territoire. |
Projet international
TASTstrategy : Combating skills mismatch of students through a transdisciplinary approach and skills transferabilityFinancement Erasmus+ En partenariat avec Universidad de Granada (Espagne), Panepistimio Kritis (Grèce), Universitatea din București (Roumanie) Le projet TASTstrategy vise à développer les stratégies d'enseignement permettant de lutter contre l'échec universitaire et de remédier à l'inadéquation des compétencesvdes étudiants par une approche transdisciplinaire et la transférabilité des compétences. Ce projet est innovant à travers trois aspects clés : le développement des compétences des étudiants transférables dans des contextes professionnels, le développement professionnel du personnel académique et en particulier le développement de leurs compétences et de leurs capacités à proposer des pédagogies innovantes, sa combinaison entre recherche-action-innovation dans un environnement d'enseignement supérieur. |
Projet régional
Etude de l'activité des chefs d’établissement scolaires de l'enseignement catholique du second degré en Maine-et-LoireEn partenariat avec DDEC 49 [direction diocésaine de l’enseignement catholique du Maine-et-Loire] et 12 chefs d’établissement du 2nd degré Ce projet de recherche a pour objectif d'analyser et de comprendre ce que peut être l’activité des chefs d’établissement scolaires du second degré, ainsi que l’activité des acteurs chargés de les accompagner. Quels sont les pratiques, les savoirs, les compétences, les difficultés de ces « managers » de l’enseignement catholique ? |
Projet national
L’Éducation à la relationEn partenariat avec DDEC 41 [direction diocésaine de l’enseignement catholique du Loir-et-Cher], Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique St Martin Ce projet a pour objectif d'intégrer de façon plus explicite et lisible la question de la relation au sein des formations. Il permet de croiser des démarches, un travail de formation et d’accompagnement des personnes tout en proposant la distanciation, l’analyse et la problématisation du travail universitaire. |
Projet international
MOEC : More Opportunities for Every Child - early detection of child difficulties in kindergartenFinancement Erasmus+ En partenariat avec Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italie), école primaire Notre Dame de la Source (France), Institución Profesional Salesiana (Espagne), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Pologne), Miejskie przedszkole nr 5 (Pologne), Istituto Comprensivo Gabrio Piola (Italie), Universidad Pontificia Comillas (Espagne), Istituto comprensivo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - Offanengo (Italie) Ces dernières années, la présence d'élèves à besoins éducatifs particuliers, présentant différents types de difficultés a été un élément en constante augmentation à l’échelle européenne dans les établissements scolaires. Cette situation a contribué à rendre la gestion des réalités éducatives de plus en plus complexe et ce, depuis l'âge préscolaire. |
Projet international
Alliance 3 : Ecole, Familles, Associations pour lutter contre le décrochage scolaireFinancement Erasmus+ En partenariat avec Université de Vic (UVIC) (Espagne), Université Eötvös Loránd (ELTE) (Hongrie), Nyborg Ungdomsskole (Denmark) Le projet Alliance 3 vise à créer des synergies avec les organisations qui dispensent une éducation formelle et non formelle et à améliorer la transition entre les différents secteurs de l'éducation, de la formation et de la jeunesse au niveau local, national et international. Le projet fournit des outils, des savoirs et des savoir-faire aux enseignants, aux animateurs socio éducatifs et aux parents pour qu’ils développent leur collaboration afin de participer activement à la lutte contre le décrochage scolaire. |
Projet national
En quoi les EPI favorisent-ils le vivre et apprendre ensemble ?En partenariat avec la DDEC 72 [direction diocésaine de l’enseignement catholique] Observer le lien entre EPI [Enseignements pratiques interdisciplinaires, mis en place par la réforme du collège (2016)] et « vivre et apprendre ensemble » |
Programme UCO
PNE : Présence et numérique en éducationLa question de la transmission des savoirs et de leur appropriation prend aujourd’hui une résonance particulière avec le développement des technologies numériques (Internet, smartphones, tablettes, réseaux sociaux, Web 2.0, etc.) Le champ de l’éducation et/ou de la formation est profondément traversé et fortement influencé par ce développement. Ce constat interroge la place et la posture des différents acteurs concernés. |
Programme UCO
Dispositif(s) virtuel(s) et encapacitation des personnes âgéesCe projet de recherche part d’un constat : les dispositifs virtuels augmentent l’empan de l’expérience humaine. En effet ils permettent de s’affranchir des repères habituels, physiques et ordinaires, de l’espace et du temps en ouvrant à la possibilité de se situer en des lieux non immédiatement accessibles et en des temps révolus ou pas encore advenus. Par ailleurs, de plus en plus d’individus dans notre société sont exposés à la vulnérabilité. Ceci notamment du fait de l’isolement et de l’allongement de la durée de la vie. Cet allongement de la durée de la vie s’accompagne fréquemment d’une perte d’autonomie et d’une diminution de certaines capacités. |














