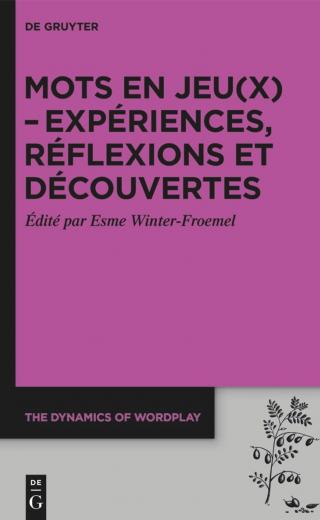CHUS
Centre de recherche Humanités et Sociétés
CHUS
Le centre Humanités et Sociétés de la Faculté des Humanités relève le défi de l’interdisciplinarité en développant des projets de recherche communs aux approches empiriques et méthodologiques variées, relevant de disciplines complémentaires.
La diversité de compétences forge l’unité du CHUS autour de thématiques fortes telles que le processus créatif, les effets de la montée en puissance des outils numériques, les publics vulnérables, les faits migratoires, les représentations politiques et identitaires, le genre ou encore l’altérité et les territoires.
Par ailleurs, le CHUS est un laboratoire d’appui pour de nombreux masters de la Faculté des Humanités, tels que le Master Communication numérique et conception multimédia, le Master Conflictualités et médiations, Master Langues étrangères appliquées, Master Spectacle vivant, gestion des projets culturels, Master Traduction et interprétation.
Les axes de recherche
Médiations, imaginaires, mutations
Territoires, altérités, circulations

Les CIRHILLa
Les CIRHILLa (Cahiers Interdisciplinaires de Recherche en Histoire, Lettres, Langues et Arts) constituent l’organe de publication du Centre de recherche Humanités et Sociétés (CHUS), de la Faculté des Humanités, Université catholique de l'Ouest (Angers)
Cette revue universitaire est dotée de deux comités, l’un scientifique, constitué d’universitaires français et étrangers, l’autre de lecture, constitué d’enseignants-chercheurs de l’UCO. Elle est publiée par l’UCO en partenariat avec les éditions L’Harmattan.
Pour en consulter la collection
Participation possible d’universitaires extérieurs à l’UCO
Directrice de publication : Gwénola Sebaux
Publications


Actualités

Colloque | 5-6 Novembre
Vieillissement et formes brèvesColloque organisé par l'unité de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en partenariat avec l'Université d'Angers et CY Cergy Paris Université. |

Séminaire | 11 Juin
EXPOSLAVSéminaire organisé par l'unité de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en collaboration avec le laboratoire CREM (Université de Lorraine) dans le cadre du projet de recherche EXPOSLAV. |

Séminaire | 22 Mai
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Colloque international | 13-14 Avril
Éduquer et former à et par la confianceColloque international organisé par le campus UCO BS à Vannes en partenariat avec Apprentis d'Auteuil et la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique du Morbihan (DDEC 56). |

Colloque international | 2-3 Avril
Management en Séries – Saison 4Colloque international organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en partenariat avec le laboratoire VALLOREM (Université d'Orléans / Université de Tours). |

Séminaire | 31 Mars
EXPOSLAVSéminaire organisé par l'unité de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en collaboration avec le laboratoire CREM (Université de Lorraine) dans le cadre du projet de recherche EXPOSLAV. |

Colloque international | 25-27 Mars
Les êtres et leurs restes - seconde éditionColloque international organisé par l'unité de recherche CHUS (Faculté des Humanités), en lien avec le projet de recherche UCO « Êtres ». |

Colloque | 19-20 Mars
L'idée d'université aujourd'huiColloque organisé dans le cadre des 150 ans de l'UCO. |

Conférence | 19 Mars
Transnational corruption and its victimsConférence organisée par l'unité de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Séminaire | 13 Mars
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Dej'Recherche | 26 Février
Le nudge administratifUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 17 Février
Généalogie de la justice socialeUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 5 Février
Crises institutionnelles, insécurité et recompositions autoritaires dans les Andes : regards croisés sur le Pérou, la Bolivie et l'ÉquateurUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Séminaire | 20 Janvier
EXPOSLAVSéminaire organisé par l'unité de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en collaboration avec le laboratoire CREM (Université de Lorraine) dans le cadre du projet de recherche EXPOSLAV. |

Dej'Recherche | 13 Janvier
Jeunesse et changement climatique : l'éco-anxiété, un levier indispensable de l'éco-responsabilité et de l'engagement environnemental ? Une comparaison France Etats-UnisUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Conférence | 12 Janvier
Fattoumi-Lamoureux, un voyage chorégraphique par-delà les frontièresConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Séminaire | 12 Décembre
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Séminaire | 9 Décembre
EXPOSLAVSéminaire organisé par l'unité de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en collaboration avec le laboratoire CREM (Université de Lorraine) dans le cadre du projet de recherche EXPOSLAV. |

Dej'Recherche | 4 Décembre
Behavioural and electrophysiological (ERP) determinants of decision-making in individuals with a smoking habitUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Colloque international | 24 Novembre
La rencontre des peuples : tension féconde et dons mutuels entre la foi chrétienne et la culture vietnamienneColloque international organisé dans le cadre des 150 ans de l'UCO, en partenariat avec l'Institut d'Histoire des Missions (Institut Catholique de Paris) et l'Institut Catholique du Vietnam (ICV), et avec le soutien de l'association Les Amis de Van. |

Journée d'étude | 20 Novembre
Les représentations genrées de l'autisme en fictionJournée d'étude organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « AuFic ». |

Séminaire | 7 Novembre
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Colloque international | 2-4 Octobre
Festival TRAMé(e)SColloque international organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités), en partenariat avec la Ville d'Angers / Les Musées d'Angers, le Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) des Pays de la Loire, l'École supérieure d'art et de design TALM, le Mobilier National - Manufacture des Gobelins et l'association Up, up and away, et avec le soutien de la chaire Entrepreneuriat et territoires de l'UCO, en lien avec le projet de recherche UCO « TRAMé(e)S ». |

Colloque international | 24-26 Septembre
Pratiques sonores de la recherche : enregistrement et réalisation, quels renouvellements épistémologiques ?Colloque international pluridisciplinaire organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche UCO « PRASORE ». |

Séminaire | 27 Juin
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Séminaire | 26 Juin
EXPOSLAVSéminaire organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en collaboration avec le laboratoire CREM (Université de Lorraine) dans le cadre du projet de recherche EXPOSLAV. |

Colloque international | 12-13 Juin
MOBIL : Migrations, mobilités, mobilisations et éthique(s)Colloque international organisé par les équipes de recherche 2S2T (Faculté SHS) et CHUS (Faculté des Humanités), en partenariat avec l'Université d'Angers et en lien avec le projet de recherche UCO « MOBIL ». |

Colloque international | 4-6 Juin
JORRESCAM 2025 : Journées de réflexion et de recherches sur les sports de combat et les arts martiaux | Reflection and research days on combat sports and martial arts | Jornadas de reflexión e investigación sobre los deportes de combate y las artesColloque international organisé par les équipes de recherche APCoSS (Faculté des Sciences) et CHUS (Faculté des Humanités) en partenariat avec Martial Arts Studies Association. | International symposium organized by the APCoSS (Faculty of Sciences) and CHUS (Faculty of Humanities) research teams in partnership with the Martial Arts Studies Association. | Conferencia internacional organizada por los equipos de investigación APCoSS (Facultad de Ciencias) y CHUS (Facultad de Humanidades) en colaboración con la Martial Arts Studies Association. |

Colloque international | 6-7 Mai
Faire vivre les monuments : Penser les expériences des publicsColloque international organisé par les équipes de recherche EGEI (Faculté DEGSP) et CHUS (Faculté des Humanités) en partenariat avec le Centre des monuments nationaux (CMN), le GIS Études touristiques et l'Université d'Angers, en lien avec le projet de recherche UCO « DEXCuPat ». |

Dej'Recherche | 6 Mai
Dej'PépitePrésentation des pépinières de recherche et avancements des projets en collaboration avec les étudiants. |

Colloque international | 24-25 Avril
« Amatrides » : éthiques de l’exil au féminin (XX-XXI siècles)Colloque international organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités), en partenariat avec les laboratoires HCTI (Université Bretagne Sud), CIRPaLL (Université d'Angers) et Escritoras y Escrituras (Université de Séville, Espagne), dans le cadre du projet de recherche UCO « MOBIL ». |

Dej'Recherche | 22 Avril
Le jeu chez l'enfant traumatiséUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Journée d'étude | 8 Avril
Transition numérique, nouvelles configurations organisationnelles et mutations professionnelles4ème journée d'étude organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en collaboration avec le laboratoire PREFICS (Université Rennes 2). |

Dej'Recherche | 8 Avril
Titre à venirUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Séminaire | 4 Avril
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Dej'Recherche | 18 Mars
Gestion du Temps et Bien-Être des Doctorants : Une Étude Qualitative du Sentiment de CulpabilitéUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Colloque international | 13-14 Mars
Sorties de guerres civiles, des guerres de religion au RwandaColloque international organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Colloque international | 13-14 Mars
« Rien que le battement d’une absence de bruit » – Rythme, souffle et silence dans les artsColloque international organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Dej'Recherche | 12 Mars
Savoirs sur le lointain et production du territoire : la construction de l'Etat péruvien depuis ses confins amazoniens (1919-1930)Un exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Séminaire | 4 Mars
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Dej'Recherche | 18 Février
La carte de TupaïaUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Conférence | 4 Février
La politique de la France au Proche-Orient aux XIXe et XXe sièclesConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Séminaire | 24 Janvier
Séminaire de recherche TRAMé(e)SSéminaire organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche UCO « TRAMé(e)S ». |

Séminaire | 20 Décembre
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Colloque international | 12-13 Décembre
Colloque du GER ComEnSS (Communication, Environnement, Science et Société) | GER ComEnSS Colloquium (“Communication, Environment, Science and Society” Study and Research Group)Colloque organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en partenariat avec la Société Française des Sciences de l'Information & de la Communication (SFSIC). |

Colloque international | 5-6 Décembre
Le cinéma ouest-allemand des « longues années 1950 » (1950-1963) au-delà des mythes, des préjugés et des topoi | Das westdeutsche Kino der langen 1950er Jahre (1950-1963) jenseits von Mythen, Vorurteilen und TopoiColloque international organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). | Internationale Tagung, organisiert vom CHUS-Forschungsteam (Fakultät für Geisteswissenschaften). |

Dej'Recherche | 3 Décembre
Transmission intergénérationnel, fiscalités et différences de productivités dans un cadre théoriqueUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Dej'Recherche | 26 Novembre
Dej'PépitePrésentation des pépinières de recherche et avancements des projets en collaboration avec les étudiants. |

Conférence | 20 Novembre
Études visuelles et imagerie populaire : bilan croiséConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Conférence | 13 Novembre
Nouveaux classiques : créer des ballets au XXIe siècleConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Dej'Recherche | 12 Novembre
Technologies XR en Recherche et InterventionsUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Conférence | 7 Novembre
Le Poème en l’honneur de Louis le Pieux d’Ermold le Noir. Un miroir pour l'empire carolingienConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Dej'Recherche | 22 Octobre
Colère, anxiété et préférences pour la redistribution des richessesUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Conférence | 14 Octobre
L’armée de Mayence en 1793 : les guerres de Vendée du côté républicainConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Dej'Recherche | 8 Octobre
Apports de la psychopathologie cognitive dans le traitement des TOCUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Colloque international | 26-27 Septembre
Réappropriations contemporaines des répertoires chantés du Moyen ÂgeColloque international organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) en partenariat avec l'Université franco-italienne et le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale (CNRS / Université de Poitiers). |

Conférence | 26 Septembre
Le son du Moyen Âge au cinémaConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités), en marge du colloque international Réappropriations contemporaines des répertoires chantés du Moyen Âge. |

Conférence | 24 Septembre
Le traité de Trianon et l’Europe centrale et orientale : de la fin de la Grande Guerre à nos joursConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Conférence | 17 Septembre
Biens publics mondiaux : la notion de patrimoine mondial / Global public goods: on the notion of World HeritageConférence organisée par les équipes de recherche CHUS (Faculté des Humanités) et SERP (Faculté DEGSP). |

Conférence | 16 Septembre
La biopolitique de la traduction chez Frantz Fanon / "Words the Color of Pulsating Flesh": The Biopolitics of Translation in Frantz FanonConférence organisée par les équipes de recherche CHUS (Faculté des Humanités) et SERP (Faculté DEGSP). |

Colloque international | 26-29 Juin
47e Congrès de l'AFEC | 47th AFEC conference47e Congrès international annuel de l’Association Française d’Études Canadiennes (AFEC), organisé par l’AFEC en partenariat avec l'équipe de recherche CHUS de l'UCO (Faculté des Humanités) et avec la participation de l’Ambassade du Canada. | 47th Annual International Conference of the Association Française d’Études Canadiennes (AFEC), organized by AFEC in partnership with the UCO's research team CHUS (Faculty of Humanities), with the participation of the Embassy of Canada to France. |

Journée d'étude | 26 Juin
Migrations, mobilisations, et éthique(s)Journée d'étude des équipes de recherche CHUS (Faculté des Humanités) et 2S2T (Faculté SHS) organisée dans le cadre du projet de recherche UCO « MOBIL » et en lien avec le projet « Mig’Get : Migration, Genre et éthique au Maroc. Regards croisés et perspectives nationales » de la MSH Ange Guépin. |

Journée d'étude | 19 Juin
Journée d’étude du projet de recherche UCO « COMEEN »Journée d’étude des équipes de recherche CHUS (Faculté des Humanités) et 2S2T (Faculté SHS) organisée dans le cadre du projet UCO « COMEEN ». |

Colloque international | 13-14 juin
Faire vivre les monuments : mises en scène, espaces et publicsColloque international organisé dans le cadre du projet de recherche UCO DEXCuPat par les équipes de recherche EGEI (Faculté DEGSP) et CHUS (Faculté des Humanités), en partenariat avec le laboratoire PREFics (Université Bretagne Sud), l'association Mêtis, Vannes agglomération: Golfe du Morbihan, la Région Bretagne et le Domaine de Trévarez. |

Cycle de conférences CHUS | 11 Juin
Cartographier le champ journalistique : questions de méthode pour une sociologie des "médias libres et indépendants" en France (1999-2024)Conférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Séminaire | 31 Mai
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Cycle de conférences CHUS | 23 Mai
La PQR est-elle toujours un acteur incontournable pour la communication territoriale ?Conférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Dej'Recherche | 16 Avril
Étude des homicides conjugaux au Québec : méthodologie, collecte et résultatsUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Cycle de conférences CHUS | 12 Avril
Faire campagne aux élections européennes sur les réseaux socionumériques : permanence et évolution des usage depuis 2009Conférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Workshop | 9 Avril
Numérique, Transformations et Gouvernance des Territoires touristiquesWorkshop organisé par l'équipe de recherche EGEI (Faculté DEGSP) en partenariat avec le CNAM Paris, dans le cadre du projet de recherche UCO « NTGT ». |

Cycle de conférences CHUS | 9 Avril
Les stratégies de communication des partis politiques dans les réseaux sociaux. Quelques enseignements tirés des méthodes numériques des sciences sociales computationnellesConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Cycle de conférences CHUS | 9 Avril
De la communication numérique à l’Élysée à celle des startups et du CAC 40 : partis pris engagés sur l’avenir de la communicationConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Journée d'étude | 6 Avril
Knock-out ? Une histoire de l’art de la boxeJournée d'étude de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités), organisée en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. |

Séminaire | 5 Avril
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Cycle de conférences CHUS | 21 Mars
Les campagnes électorales vues du côté des internautes contestataires ou l'ère de la "démoqueratie"Conférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Cycle de conférences CHUS | 20 Mars
Le roman national des marquesConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Cycle de conférences CHUS | 20 Mars
Faire campagne en ligne au Québec. Stratégies et pratiques partisanesConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Séminaire | 4 Mars
Séminaire de recherche TRAMé(e)SSéminaire organisé par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche UCO « TRAMé(e)S ». |

Dej'Recherche | 28 Février
Bridging minds and markets: exploring the neuroeconomic frontierUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Séminaire | 23 Février
Séminaire général CHUSSéminaire de l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Dej'Recherche | 13 Février
Titre à venirUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Workshop | 9 Février
La communication politique en quête de légitimation ? Retour sur une pratique aux frontières de la rhétorique et du marketingWorkshop recherche organisé par la Faculté des Humanités dans le cadre de son Master LEA (LACISE/LARISP). |

Cycle de conférences CHUS | 9 Février
Quel récit pour la culture dans les territoires ?Conférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Cycle de conférences CHUS | 5 Février
La communication sensible : nouvelle frontière de la communicationConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités) dans le cadre du projet de recherche ANR « MUTADATA ». |

Conférence | 31 Janvier
Écriture, subversion et utopie dans l'œuvre du chorégraphe Bernardo MontetConférence organisée par l'équipe de recherche CHUS (Faculté des Humanités). |

Dej'Recherche | 30 Janvier
Rechercher en enseignement en olfaction : enjeux, difficultés, intérêts, exemplesUn exercice de communication pendant lequel les Maîtres de Conférences de l'UCO Niort ou des intervenants extérieurs présentent leurs travaux de recherche. |

Workshop | 18 Janvier
Ukraine : mémoires de guerres, histoire(s) en guerreWorkshop recherche organisé par la Faculté des Humanités dans le cadre de son Master LEA (LACISE/LARISP). |

Workshop | 11 Janvier
Enjeux prospectifs et défis à venir pour les managers de l’entreprise « d’après »Workshop recherche organisé par la Faculté des Humanités dans le cadre de son Master LEA (LACISE/LARISP). |
Programmes de recherche
Projet national
Eco-design : Approches humaines pour des objets numériques durablesFinancement PEPR NumEco PC2 En partenariat avec Université de Lille, CEA, Institut Mines-Télécom, Université de Strasbourg, Université Bretagne Sud, Sorbonne Université, INSA Lyon et Rennes, Université de Bordeaux, Université Sorbonne Nouvelle L'objectif principal du projet est d'analyser l'éco-socio-conception en tant que démarche d'ingénierie et d'innovation sociale. Le projet se propose d'analyser les engagements et les valeurs écologiques auxquelles les concepteurs se rendent sensibles et d'interroger l'outillage des démarches d'éco-socio-conception qui permettent la définition d'objectifs, de moyens et l'évaluation des résultats. |
Projet international
FIMEMO : First Memories and Forms of KnowledgeFinancement ANR FRAL En partenariat avec Centre Marc Bloch (Allemagne), Technische Universität Berlin (Allemagne), Université du Rwanda (Rwanda), Universität Mainz (Allemagne) Le projet FIMEMO propose d'étudier les « premiers savoirs » produits par les survivants et les communautés atteintes, diasporas comprises, à la suite d'un génocide. Il se concentre sur les deux premières décennies qui ont suivi la Shoah (1944-1964) et le génocide des Tutsi au Rwanda (1994-2014), et sur les pratiques matérielles et mémorielles qui ont émergé pendant cette période. Son ambition est d'explorer la valeur heuristique d'une approche interdisciplinaire en mettant en dialogue les recherches récentes dans le champ des études sur l'après-coup de la Shoah (« Aftermath Studies ») et le champ, encore peu exploré, s'intéressant à l'immédiat après-coup du génocide des Tutsi. |
Projet national
AuFic : Les représentations genrées de l’autisme en fictionFinancement ANR JCJC En partenariat avec IAE de Poitiers, Université de Lille, Université Paris 8 Le projet AuFic a pour objectif d’étudier comment les personnages autistes sont représentés dans les œuvres de fiction diffusées en France et la réception de ces représentations par les personnes autistes elles-mêmes. |
Projet régional
EcoWeb : L'éco-conception de sites web dans les démarches de sobriété numérique des collectivités territorialesFinancement Région Bretagne En partenariat avec Université de Rennes, Université Grenoble Alpes, Université de Sherbrooke (Canada), Université de Technologie de Compiègne Ce projet analyse les enjeux socio-politiques de la conception de sites web institutionnels moins énergivores et respectueux des limites planétaires. Il se décline en deux axes : le premier porte sur les représentations des enjeux écologiques du numérique par les collectivités territoriales et les professionnels de l’éco-conception ; le deuxième axe se consacre à l’analyse des pratiques d’éco-conception dans leur diversité. À terme, le projet vise à structurer un réseau de recherche international pour cartographier les politiques de sobriété numérique et accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche. |
Projet UCO | Projet classique
COMEEN : Communication et médiation écologique, éthique et numériqueEn partenariat avec INRAE, Université catholique de Louvain, Université de Limoges, Université Côte d’Azur Ce projet de recherche analyse les formes de médiation et de médiatisation liées aux transitions écologiques et numériques. Il interroge l’engagement écologique et les modes d’organisation durables et éthiques à partir des dispositifs de médiation, des usages et des stratégies. |
Projet UCO | Projet Tremplin
PACE 3 : Publics – artistes – créations – expériencesEn partenariat avec TU Nantes, Université du Québec à Montréal (Canada) Ce projet s’inscrit dans le prolongement des 2 premiers projets PACE financés par la MSH Ange Guépin. Il étudie la scène de la danse et des dispositifs de soutien et de professionnalisation à destination des artistes émergents du spectacle vivant à Nantes et à l'international (Canada). |
Projet UCO | Projet classique
TRAMé(e)S : Tissages, Représentations, Arts et MétissageSEn partenariat avec Ecole supérieure d'art et de design Angers, Institut national d'histoire de l'art, Frac des Pays de la Loire, Musées d’Angers, Conservation départementale du patrimoine Maine-et-Loire, Institut des textes et manuscrits modernes Pratique résolument hybride, passant d’artisanat à art modeste voire bricolage, l’art textile, en raison de son histoire particulière sur le territoire est un sujet particulièrement porteur d’actualité . Travailler les questions de métissages (art majeur/mineur – représentations artistiques/populaires – créolisations et genres dans la création – regards croisés médiéval/contemporain …) se pense comme une mise en abîme du propre métissage théorique et méthodologique de notre équipe de recherche. Les « travaux d’aiguilles » se veulent un carrefour des productions et actions protéiformes engagées sur trois ans par TRAMé(e)S, équipe riche de la singularité des membres qui la compose. |
Projet UCO | Projet Tremplin
PRASORE : PRAtiques SOnores de la REchercheEn partenariat avec Université de Poitiers, Université de Montréal (Canada), Université Concordia (Canada), Université d’Algarve (Portugal), Fondation pour la Mémoire de la Shoah Ce projet s’inscrit dans une démarche transdisciplinaire et une démarche de recherche création. Il place les usages du medium sonore par les chercheurs au cœur de sa problématique. Il prend acte du développement intensif des productions sonores numériques natives désignées sous le terme générique de « podcasts » pratiqués par de nombreux acteurs culturels (musées, spectacle vivant, centre d’art contemporain, journalisme, radio et webradio) et scientifiques (les podcasts de l’EHESS, France culture : les conférences des universités …). Le projet bénéficie d'un cofinancement de la part de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. |
Projet UCO | Projet classique
MOBIL : Mobilités, migrations, mobilisationsEn partenariat avec MSH Ange Guépin, Université d'Angers, Université Clermont Auvergne, Université de Gießen (Allemagne), Université Ibn Zohr (Maroc), Université Pompeu Fabra (Espagne) Penser la migration en mettant en perspective mobilités et mobilisations, deux notions avec des interactions riches mais rarement interrogées dans une perspective transversale et interdisciplinaire. Il s’agit d’abord d’appréhender leur évolution conceptuelle face à de nouveaux défis émergents dans les sociétés (post-) migratoires en pleine mutation. Le projet MOBIL entend ainsi examiner les enjeux politiques et sociaux propres aux sociétés plurielles, pour apporter des clés de compréhension et des pistes pour l’action politique et la société civile. En mobilisant l’éthique comme outil épistémologique pertinent, il propose d’analyser la dialectique entre les deux notions clé au cœur du projet MOBIL. |
Projet UCO | Projet classique
IVORies : Investigation and Valorization of Roman IvoriesEn partenariat avec Centre Jean Bérard (CNRS-Ecole Française de Rome), Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Italie), Parco Archeologico di Pompei (Italie), IRAA, Université Lille III, Université Libre de Bruxelles (Belgique) Ce projet de recherche-action vise à adopter une démarche interdisciplinaire, entre histoire, archéologie, arts plastiques et arts immersifs, sciences de l’information et de la communication et sciences cognitives. L’étude de l’ivoire est abordée au cœur d’une réflexion sociale, mais aussi historique et religieuse. Ce matériau précieux est étudié conjointement avec celui de l’os ouvragé, beaucoup plus répandu. L’artisanat et les usages de l’ivoire et de l’os sont appréhendés au sein d’une dynamique sociale à l’échelle de la ville de Pompéi, entre une étude des objets dans leurs contextes, tant funéraires que domestiques, et le projet de fouille d’un atelier du travail de l’os (en I 16, 3). Parallèlement, la création d’un catalogue des ivoires et des os du Musée archéologique national de Naples est en cours pour mettre à disposition de la communauté scientifique et du plus grand nombre l’ensemble d’une collection exceptionnelle. |
Projet UCO | Projet classique
DExCuPat : Dispositifs et Expériences en Culture et PatrimoineEn partenariat avec Université Rennes 2, Université de Bretagne Occidentale, Université de Bretagne Sud, Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, La Voyage à Nantes, Château des Ducs de Bretagne, Domaine de Suscinio, Domaine de Trévarez, Château de Fougères Le projet DExCuPat réunit une équipe interdisciplinaire qui entend questionner des dispositifs, notamment numériques, et des expériences de publics dans plusieurs institutions culturelles et patrimoniales en Bretagne et Pays de la Loire. L’objectif principal de ce projet est de questionner la façon dont les mutations sociétales actuelles, appuyées sur la technologie, impactent les institutions patrimoniales et le domaine de la médiation culturelle. Cette recherche action s’appuie sur une collaboration étroite déjà initiée avec les acteurs socio-professionnels du territoire et entend créer une dynamique de recherche collective au sein du campus de l’UCO Bretagne Sud. |
Projet UCO | Projet Tremplin
Trouver la mort en Anjou. Les êtres et leurs restesEn partenariat avec entreprise Charier, Commune de Baugé-en-Anjou, Conservation départementale du patrimoine (Maine-et-Loire), DRAC, INRAP, CNRS, École des hautes études en sciences sociales de Paris, Université d'Aix-Marseille La bataille du Vieil-Baugé, qui s’est déroulée le 20 mars 1421, est la première victoire des troupes franco-écossaises contre les Anglais menés par le duc de Clarence, frère d’Henri V, pendant la guerre de Cent Ans. L'objectif de ce projet est de travailler sur l’histoire anthropologique de cette bataille, les êtres et leurs restes : que sait-on notamment du devenir du corps Anglais qui y trouvèrent la mort ? Différentes recherches seront mises en œuvre : l’analyse des sources et un projet de prospection archéologie afin de retrouver les corps des peut-être 300 Anglais qui périrent à Baugé. |
Projet UCO | Projet classique
NTGT : Numérique, Transformations et Gouvernance des Territoires touristiquesEn partenariat avec Domaine national de Chambord, Communauté de communes Grand Chambord, Université d'Angers, Nantes Université, Université d’Orléans, CNAM, Universitat de Valencia (Espagne) Ce projet questionne l’introduction et la montée en puissance du numérique au sein des organisations touristiques et des territoires de manière générale, ainsi que les transformations des métiers qui résultent de ces évolutions technologiques. D’autre part, il introduit des réflexions sur l’analyse et la proposition de nouvelles formes de gouvernance des destinations touristiques, ceci en s’adaptant aux nouveaux enjeux liés à l’évolution numérique des territoires qui portent ces destinations. |
Projet UCO | Projet Tremplin [[Projet terminé]]
P.A.L.I.E.R. : Perceptions et Affects dans les Langages par Immersion et Émersiologie dans nos RéalitésEn partenariat avec Université Savoie Mont-Blanc, Université Paris Descartes, Université Paris 8, Festival Rect VRso Le projet P.A.L.I.E.R. se veut être une approche transdisciplinaire des manifestations affectives et perceptives, encourageant un dialogue entre les disciplines, les approches épistémologiques et émersiologiques des émotions dans les processus physiologiques, psychologiques, langagiers et leur modélisation, comme c’est le cas dans l’immersion et dans nos réalités. Le but de ce projet de recherche est d’articuler les affects et leurs perceptions entre théorie et historiographie, questionnant l’expérimentation esthétique spatio-temporelle. Il s’agit également de réaliser un état des lieux des catégorisations émotionnelles, tout en (re)plaçant l’individu et son authenticité. |
Projet national
MUTADATA : Les mutations du travail politique au prisme des big dataFinancement ANR JCJC En partenariat avec Laboratoire Arènes (Rennes) Le présent programme de recherche interroge la professionnalisation d’une nouvelle expertise politique sous le prisme des big data. Porter le regard sur les prestataires spécialisés dans la collecte, la gestion et l’analyse des bases de données permet d’interroger les fluctuations des frontières partisanes et les reconfigurations du travail politique, à travers l’analyse d’un espace professionnel composite et hybride, tiraillé entre professionnalisation, expertise et militantisme. |
Projet UCO | Axe 1 [Projet terminé]
Le travail des représentations dans un dessin animé : une analyse croisée de la production et des fans de MiraculousLe projet explore la façon dont un dialogue entre la production et le fandom de la série animée Miraculous. Les Aventures de Ladybug et Chat Noir (TF1, 2015-…) a pu s’instaurer et permettre l’émergence de représentations (notamment de genre et de sexualité) plus ou moins alternatives, aussi bien dans les productions des fans que dans les épisodes de la série. |
Projet UCO | Axe 1 [Projet terminé]
Ecologie, Ethique et NumériqueCe projet fait converger les enjeux de l’écologie, de l’éthique et du numérique pour analyser les formes de médiation, de médiatisation, d’innovation liées à la transition écologique comme les impacts sociaux et environnementaux des usages du numérique. |
Projet UCO [Projet terminé]
RupturesRenforcer la cohésion et le dynamisme de l’équipe, en s’ouvrant à des postulats scientifiques et à des outils méthodologiques nouveaux. |
Projet UCO | Axe 1 [Projet terminé]
Mythologies du moi : écrire-représenter-construire l’individuÉcrire et représenter le sujet a toujours été l’une des préoccupations majeures de toute société : autobiographies, journaux intimes, mémoires, témoignages historiques, biographies, récits de vie et autoportraits en tout genre ont en effet construit l’histoire de l’humanité. Dans le monde contemporain, cela semble devenir une émergence car tout individu peut se dire et se mettre facilement en scène grâce au nouveau paradigme qui a révolutionné notre quotidien : le numérique. Réseaux et médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat), blogs de publications personnelles périodiques et régulières, sites de développement personnel et coaching, offrent toute sorte de possibilité de création, de construction ou de composition de l’image de soi. |
Projet UCO | Axe 2 [Projet terminé]
Le trouble/ La brouille du vivant - Projet Tempête en partenariat avec le TALM-Le Mans (Rachel Rajalu)Depuis plusieurs décennies, les sociétés humaines connaissent des transformations profondes de leurs environnements, leurs valeurs et leurs manières de vivre. Disparition progressive de milieux et d’écosystèmes, migrations forcées (Didier Fassin)... |
Projet UCO | Projet classique [Projet terminé]
“Tricoteuses !" Femmes et création textile du Moyen Age à l’époque contemporaineLa création textile (broderie, tapisserie, etc.) du Moyen Age jusqu’à l’époque actuelle est un domaine au sein duquel les femmes sont largement partie prenante, et pourtant leur présence, bien que connue et attestée, est le plus souvent invisibilisée... |
Programme UCO
TDC : Technologies et défiance citoyenne - réenchanter la démocratie avec le numériqueCe projet pluridisciplinaire rassemble des enseignants-chercheurs de science de l’information et de la communication, de science politique, d’histoire, de sciences de l’éducation, de linguistique de l’UCO et d’autres universités françaises et canadiennes. Il vise à étudier le renouvellement de la participation des citoyens à la prise de décision collective au sein, ou à l’extérieur, des organisations politiques, au prisme du numérique, dans un contexte caractérisé par une défiance grandissante. Le recours au numérique permet-il de réenchanter la démocratie ? |
Projet national
SCAENA : Scènes Culturelles, Ambiances Et TraNsformations urbAinesFinancement ANR PRC En partenariat avec Université d'Angers, Nantes Université, Université de Grenoble, Université Grenoble Alpes, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, MSH Ange Guépin En s’appuyant sur le concept de scène, SCAENA propose de développer un corpus à la fois théorique, méthodologique et empirique afin de saisir les encastrements complexes qui s’opèrent entre une offre culturelle et artistique située, la co-présence de start-up ou d’entrepreneurs créatifs dont les artistes sont une catégorie, les configurations urbaines et l’organisation sociale d’un territoire.
|
Projet national
PACE 2 : Publics-Artistes-Créations-ExpériencesFinancement MSH Ange Guépin Projet collaboratif mené par une équipé pluridisciplinaire et internationale de chercheurs en sciences humaines et sociales et arts du spectacle qui travaillent sur différents terrains et champs artistiques pour analyser et comparer l’articulation des processus de création / production / diffusion / médiation. |
Projet régional
CITɛR : L’Europe et les frontières de la citoyennetéFinancement Alliance Europa - Pays de la Loire En partenariat avec les universités d'Angers, de Nantes, de Paris II Assas, de Lille I, de Turin (Italie), d’Osnabrück (Allemagne), d'Innsbruck (Autriche), Ibn Zohr d’Agadir (Algérie), de Gießen (Allemagne), CNRS (Nantes) et Maison de l'Europe (Angers et Nantes). L’objectif de ce projet est de renouveler les problématiques sur la citoyenneté européenne en l’abordant à partir de l’histoire de ses marges juridiques, géographiques, sociales, philosophiques, dans une perspective globale et de longue durée. |